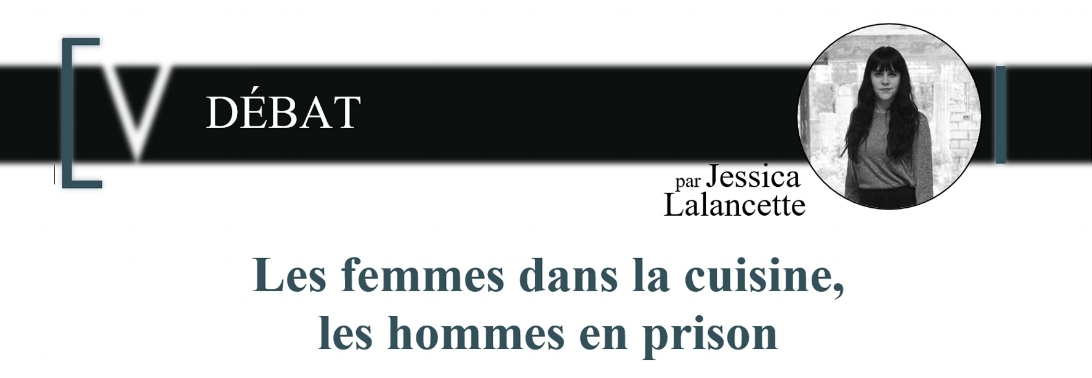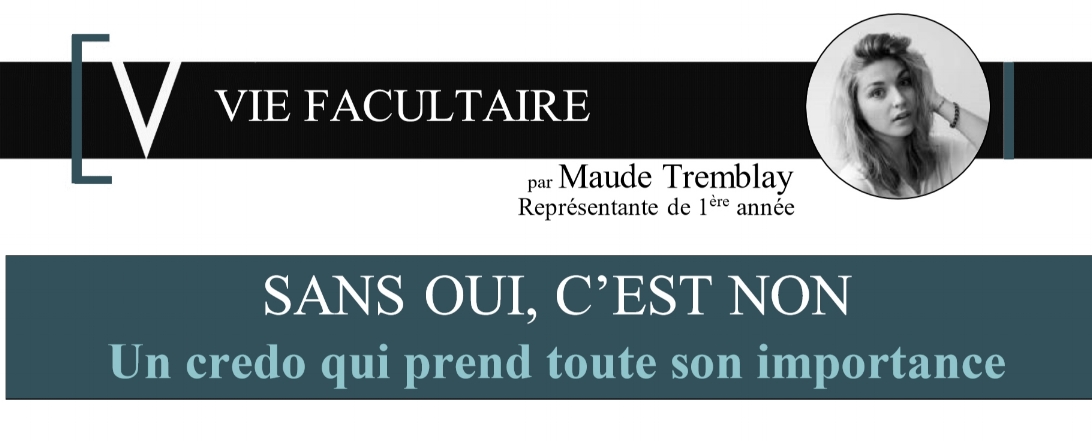#Plusmaintenant
Du revers de la plume, on rejette les ébauches rédigées au début du mois. Une éternité semble s’être écoulée depuis les frasques de Trump à l’égard des joueurs de football américains. Aujourd’hui, ma page se noircit toute seule, animée par cette salve de #moiaussi qui résonne un peu partout sur le globe et dont l’écho se réverbère de manière particulièrement bruyante ici au Québec. Cette parole, trop longtemps étouffée, se libère enfin et emporte avec elle un dialogue et une prise de conscience réconfortants.
À ce sujet, saluons toutes celles qui ont eu la force de dénoncer, et tous ceux qui ont eu le courage d’écouter ou même de demander pardon. S’excuser, car des torts nous en avons tous collectivement. Et trop souvent, à défaut de s’assumer, on rejette l’ensemble de la responsabilité sur les frêles épaules des victimes qui n’ont pourtant rien demandées. Socialement nous avons un nombre effarant de questions à nous poser, c’est une culture entière qu’il faudra repenser.
Mais en tant que juristes, nous nous devons aussi de réfléchir. Quand les victimes se détournent massivement du système de justice pour s’en remettre au tribunal du peuple, c’est qu’à un certain point, nous avons failli à notre tâche.
À la vue des commentaires machistes et rétrogrades tenus par certains juges et procureurs en audition, on peut comprendre cette perte de confiance. La victime est « en surpoids », « fleur bleue », « présente une malformation vaginale » ou aurait dû « garder ses genoux joints » pour se protéger. Un brin dissuasif, on en convient, ce n’est probablement pas l’oreille attentive qu’espéraient les victimes. Certes, il ne faut pas atténuer l’importance de la recherche de la vérité, ni les lourdes conséquences qui attendent l’accusé s’il est condamné à l’issue d’un procès. Or, ne serait-il pas possible de tendre vers une meilleure balance des inconvénients entre les plaignants et les accusés? À cet égard, l’instauration d’un code d’éthique à respecter lors du contre-interrogatoire des victimes d’agressions sexuelles pourrait être à envisager.
Cela étant, devant cet échec relatif du système de justice, les médias sociaux se sont emparés de la problématique. Sont apparus les mouvements #agressionsnondénoncées en 2014 et #moiaussi en 2017. Ces mouvements, qui sont une forme incomparable d’empowerment, permettent aux victimes de se libérer d’un fardeau énorme. Ils permettent également une prise de conscience populaire et un changement de mentalité. Mais viennent également avec ces mouvements des inconvénients majeurs. Ils ne représentent qu’une solution ponctuelle à un problème continu. Par ailleurs, en soumettant les accusations au seul tribunal du peuple, les dénonciations médiatiques ne garantissent pas la protection des droits fondamentaux des accusés. Ainsi, malgré leurs récents impacts salutaires, les mouvements comme #metoo ne peuvent pas constituer une solution à long terme.
Et c’est ici que notre rôle de jeunes juristes devient fondamental. Nous sommes confrontés à un problème : le rejet du système judiciaire inadapté aux cas d’agressions sexuelles, au profit du système médiatique, moins contraignant, plus spectaculaire, mais au combien plus dangereux.
Constatant cette réalité, nous nous devons de réfléchir à une solution alternative. Le processus de médiation pénale paraît être une avenue intéressante. Déjà implanté auprès des adolescents et des autochtones, il s’agit d’une approche réparatrice permettant aux victimes et à leurs agresseurs de trouver eux-mêmes, avec l’aide d’un médiateur professionnel, une solution à leur problème. Lorsque l’on sait qu’environ 80% des personnes agressées avouent l’avoir été par un membre de leur entourage, et que 30 % d’entre elles ne souhaitent pas que leur agresseur aient de démêlés avec la justice, l’avenue de la médiation semble d’autant plus pertinente. Encore plus, sachant que cette solution permet aux victimes de s’impliquer activement dans le processus judiciaire et d’entreprendre leur guérison plutôt que d’être de simples témoins passifs et utilitaires, abandonnés à leur souffrance.
Elles ont osé parler, ayons le courage de changer