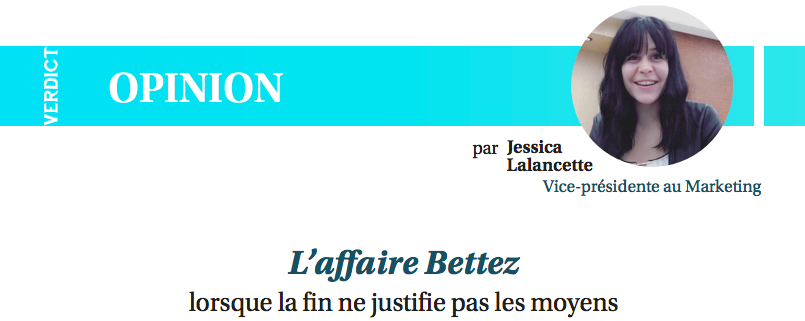S’étant largement impliqué dans la vie étudiante durant ses études, Simon a su se démarquer en obtenant sa place en tant que vice-président aux affaires académiques dans l’AED et stagiaire chez Stikeman Elliott. Dans cette entrevue, il nous offre entre autres quelques conseils sur les techniques d’études à adopter et sur l’attitude à maintenir face aux embûches.
Parle-nous un peu de toi, ton parcours universitaire et ton poste à l’AED.
J’ai eu un parcours un peu atypique. Ça fait déjà quatre ans que je suis à l’université. J’ai fait une session en communications, deux en administration et une autre en sciences politiques avant d’en arriver au bac en droit. Je sais que ça étonne plusieurs quand je leur dis que j’ai été refusé à la Faculté deux fois avant d’être admis, considérant le poste que j’occupe à l’AED en tant que VP académique. Je crois que ce n’est pas parce qu’on part parfois avec un peu plus de difficulté dans nos études que ça ne peut pas se redresser par la suite.
En ce qui concerne l’AED, le poste de VP académique m’a intéressé dès que je suis entré à la faculté. C’est pour ça que je me suis impliqué au Centre de mentorat l’année passée ; j’ai toujours voulu aider les étudiants. Je connais un peu le bac sur le bout de mes doigts et toutes les possibilités qui y sont offertes, comme les stages et les cheminements différents qui sont proposés, donc c’est sûr que d’aider les étudiants à travers les différentes choses qui sont offertes à la Faculté, ça me fait énormément plaisir. Pour ce qui est des examens et des révisions de notes, je pense aussi être une bonne ressource pour accompagner les étudiants dans le processus.
En tant qu’ancien mentor, aurais-tu quelques stratégies d’étude ou de prise de notes à nous donner ?
Je pense que le plus important, et c’est souvent la partie qu’on oublie de faire, étant donné qu’on a nos ordinateurs en classe, c’est vraiment d’écouter ce que le professeur dit, de prendre de solides notes et de laisser de côté les médias sociaux pendant les cours. Après, c’est certain que de toujours être à jour, c’est la clé. C’est aussi de bien cibler ses lectures, de vraiment se concentrer tout d’abord sur la loi, ensuite sur la jurisprudence, en faire une lecture ciblée pour voir ce qui est vraiment important, de sortir les ratios et, ensuite, s’il y a quelque chose que l’on n’a pas compris, de compléter avec la doctrine. Mon conseil, évidemment, est de ne pas commencer avec la doctrine et d’essayer de tout maîtriser ce qu’il y a là-dedans parce que c’est avant tout un résumé de ce que l’on a vu durant les cours. Il faut suivre nos lectures par rapport à ce qui est le plus important et se créer une pyramide de priorités dans nos études.
Beaucoup d’étudiants de première année hésitent à s’impliquer dans la Faculté et à participer aux activités qui sont organisées. Qu’est-ce que tu leur répondrais ? Est-ce que c’est possible de concilier études, travail et implications extracurriculaires tout en maintenant des bonnes notes ?
Ce que je disais quand j’étais au Centre de mentorat l’an passé, et je le dis toujours, c’est que ça devrait l’être. Si ça ne l’est pas, ça peut être une alarme que quelque chose ne fonctionne pas dans les méthodes que l’on prend pour étudier. Oui, c’est un bac exigeant, c’est 99 crédits en trois ans et ce sont des cours qui nécessitent beaucoup d’étude, mais au nombre de gens qui le font et qui réussissent bien tout en trouvant moyen d’aller aux partys les jeudi soirs et de s’impliquer dans divers comités, c’est très faisable. Si on en est à un stade où on étudie tellement et on ne fait tellement que des lectures que nos études nous prennent un 50 heures à chaque semaine, c’est un indice, selon moi, que l’on devrait peut-être aller faire un tour au Centre de mentorat pour voir pourquoi on n’est pas capable d’être plus efficace dans notre gestion de temps et dans notre façon de comprendre la matière.
Avoir du succès au stade universitaire, c’est aussi savoir maintenir une bonne hygiène de vie. Comment les étudiants peuvent-ils apprendre à gérer le stress des examens et la pression de performance ?
Je pense qu’il faut toujours relativiser. Je sais que beaucoup ont le sentiment qu’après un examen qui a moins bien été, leur perspective d’emploi est fichue, mais il faut toujours se rappeler que toutes les pentes sont surmontables et qu’il ne faut jamais lâcher. Ce n’est pas parce qu’un examen a mal été que ce sera le cas pour les autres. Il faut se rappeler que les gens qui ont été acceptés dans le baccalauréat sont, à la base, des personnes brillantes qui ont une facilité à l’école, et qui ont les capacités pour réussir. On n’est pas plus fou qu’un autre. En mettant les efforts nécessaires, tout le monde est capable d’y arriver, certainement.
Quelle serait ta priorité en tant que vice-président aux affaires académiques ?
Il y a beaucoup de choses que l’on essaie de changer à l’interne de la Faculté. On en est encore au stade préliminaire, mais c’est d’éliminer beaucoup de facteurs de stress qui existent à la Faculté en ce moment. L’une des choses dont nous avons longuement discuté, c’est la folie autour des choix de cours. Beaucoup d’étudiants se réservent des cours, d’autres en vendent et les cours les mieux réussis partent extrêmement vite. Pour avoir été dans 3 autres facultés avant celle-ci, je peux garantir que ce phénomène n’existait pas, notamment parce qu’il s’agissait de programmes moins compétitifs et surtout parce que tous les examens étaient les mêmes pour chaque cours, peu importe le professeur choisi.
Selon nous, la priorité devrait vraiment être axée sur la matière, sur la pédagogie des professeurs et non pas sur la facilité d’un examen. On est en train de voir avec la Faculté s’il n’y aurait pas des façons que les cours soient un peu plus uniformes, c’est-à-dire que, par exemple, en ayant le cours de droit des biens avec un professeur, ça ne soit pas nécessairement vraiment plus facile qu’avec un autre. Je comprends aussi parfaitement qu’on se sent désavantagé lorsqu’on se retrouve avec le professeur dont la moyenne est de 60%, alors que l’autre, pour le même cours, est de 75 ou 85%. La Faculté s’est montrée très sensible à cette problématique et des solutions sont actuellement sous la loupe.
Cet été, tu as eu la chance de travailler en tant que stagiaire au cabinet Stikeman Elliott, à Montréal. Pourrais-tu nous parler de ton expérience ? Qu’est-ce que c’est, vraiment, de travailler dans un grand cabinet ?
C’est une très belle expérience. J’ai eu la chance de commencer mon été en litige. C’est vraiment d’apprendre concrètement ce que l’on voit dans nos cours, de voir comment ça se pratique dans la vraie vie, étant donné que ce que l’on voit dans nos examens ressemble souvent à du litige. Mais tout ce que l’on voit à l’école, c’est le jugement. On ne voit pas les mille et unes procédures qu’il y a eu avant, comme les demandes en rejet ou les interrogatoires préalables. Donc c’était très enrichissant d’avoir pu aller au-delà du jugement pour assister à différentes parties du processus judiciaire et d’être confronté à la réalité voir tout le processus, qui est extrêmement long, pour en arriver au jugement final, ou, dans 90 % des cas, à des règlements hors cour. C’est donc très enrichissant et formateur d’avoir pu assister à différentes parties du processus judiciaires et d’être confronté à la réalité que l’on oublie souvent à l’université, soit que la grande majorité des litiges se règlent hors cours.
Ce que l’on fait en litige dans un bureau d’avocats, premièrement, c’est beaucoup de recherche. Souvent, les avocats vont avoir des questions sur des points de droit sur lesquels ils veulent qu’on leur sorte des autorités pertinentes afin de se faire une tête sur l’angle qui nous sera favorable. On fait aussi de la rédaction de premiers jets de procédures pour que l’avocat ait le squelette de sa procédure avant de la compléter. Il va ensuite ajouter ou corriger certaines parties de la procédure que l’on aurait pu mieux écrire, donc c’est vraiment formateur. Tu as donc un bon «feedback» en voyant le résultat final et de fois en fois, la qualité de ce que tu écris s’améliore. On assiste aussi parfois les avocats à la Cour, quoique, pendant l’été, il n’y en ait pas énormément. Toutefois, il y a plein d’autres choses qui se font. Par exemple, j’ai assisté à une assemblée des créanciers dans un contexte de faillite, où j’ai pu voir l’avocat avec qui je travaillais plaider les arguments qu’on avait préparés. C’était vraiment très formateur.
Depuis que l’été est terminé, je travaille toujours au bureau à temps partiel, et comme nous ne sommes pas attitrés à un département en particulier pendant les sessions universitaires, j’ai la chance d’ouvrir mes horizons. Depuis septembre, j’ai travaillé sur différents mandats en valeurs mobilières et en droit du travail, choses que je n’avais pas faites cet été. L’expérience est intéressante afin d’éventuellement faire un choix final quant à ma pratique, une fois mon stage du Barreau complété.
Tu as dit que tu avais été refusé deux fois du bac avant d’avoir été accepté, justement, comment fais-tu pour gérer les échecs? Comment les autres étudiants, qui ne se sentiraient pas à la hauteur du bac en droit pourraient-ils eux-mêmes gérer ça ?
Je pense que la clé, c’est de persévérer. Même si j’ai été refusé deux fois, ça ne m’a pas empêché de postuler une troisième fois et si j’avais encore été refusé, j’aurais probablement postulé une quatrième fois encore. Je pense que nous sommes toutes des personnes déterminées et prêtes à prendre les moyens nécessaires afin d’arriver à nos objectifs. Chaque parcours est différent et peut être parsemé d’embuches. Si on veut vraiment poursuivre une carrière de juriste, il ne faut jamais lâcher. Même s’il y a des obstacles devant nous, c’est de toujours garder notre but en tête.
Ce n’est pas parce quelqu’un termine le bac avec une cote Z sous la moyenne qu’automatiquement, il sera un mauvais juriste. Au contraire, il faut comprendre que la formation académique est ce qu’elle est, mais que la pratique n’est pas un examen de deux heures et demie qu’il faut remplir avec toutes les réponses au bout de nos doigts.
Finalement, que vas-tu retenir de ton passage en droit à l’Université Laval ?
Je pense que ce sont les liens que j’ai tissés avec gens. En ce moment, mon expérience sur l’exécutif de l’AED me permet de connaître de nouvelles personnes à la Faculté. Le nombre de gens qui s’impliquent est incroyable. C’est rempli de personnes formidables dont je vais être déçu de perdre de vue en allant travailler à Montréal, mais je sais que c’est des rencontres qui m’ont marqué.
Au-delà des compétences juridiques acquises, le passage à la Faculté a tellement à nous offrir pour se développer personnellement. Les défis qu’on peut y surmonter sont multiples. Je me rappelle avoir participé au concours oratoire de l’AED en première année et me sentir intimidé d’avoir à livrer un discours devant des avocats. C’est le genre d’expérience où on fonce parfois la tête baissée, mais qu’on en ressort la tête haute.
Mon conseil, pour ceux qui ont encore plusieurs sessions devant eux, est évidemment de profiter au maximum de votre passage à la Faculté, qui a énormément à offrir.